Entre février et mars 2025, la Banque Mondiale (BM) a publié 3 rapports d’évaluation portant sur la facture économique de la « guerre » en Ukraine et des « conflits » à Gaza et au Liban. Ces rapports se prêtent à une lecture comparative portant sur leur méthodologie d’évaluation supposée être « standardisée et suffisamment reconnue internationalement » (BM 2025a, p. 52). Un regard croisé offre ainsi un éclairage critique sur la construction politique des évaluations de la BM et, a fortiori, sur leurs multiples instrumentalisations au sein des relations internationales.
Dans les rapports de la BM sur la Palestine, le mot guerre ne figure jamais dans le texte, on y fait exclusivement référence aux « conflits » (conflit de 2023, conflit de 2021, conflit de 2014, etc.). De même, dans les rapports sur le Liban, le mot « guerre » n'apparaît jamais non plus, sauf dans de rares références bibliographiques, et la seule occurrence du mot « Israël » figure dans une référence en note de bas de page.
Cette disparité n’est pas fortuite. En omettant toute référence à la guerre ou aux agresseurs dans les contextes libanais et palestinien, la BM contribue à dépolitiser la violence. Elle efface ainsi la possibilité de reconnaître des crimes de guerre et, en concentrant ses estimations de dommages principalement sur le logement, elle occulte les pertes subies dans les services publics, les systèmes de sécurité sociale et les droits humains, en particulier celles causées par des armes interdites comme le phosphore blanc.
Consultez le rapport complet pour une analyse critique et comparative de la manière dont les institutions internationales réécrivent les guerres, et de ce que cela implique pour la responsabilité internationale.
Read More at: https://civilsociety-centre.org/resource/quand-la-banque-mondiale-%C3%A9value-la-guerre-en-ukraine-et-les-conflits-en-palestine-et-au Copyrights © 2025 Lebanon Support. All rights reserved.
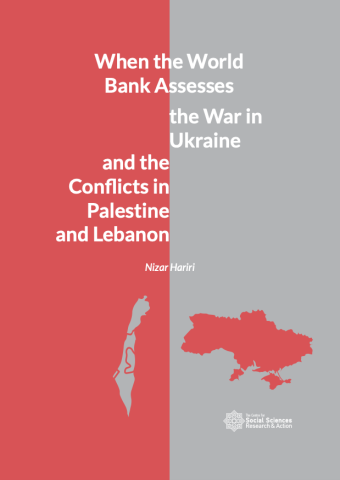
1. Les délimitations spatiales et temporelles : les échelles politiques des évaluations
2. Des évaluations dans des contextes de guerres ou de conflits
3. Le statut des victimes de guerres : focus sur les violences basées sur le genre
4. Focus sur la santé et la protection sociale en temps de guerres ou de conflits
5. Le droit de l’État comme préalable à la construction du droit des victimes
6. Les incertitudes environnementales de la BM au Liban et à Gaza
7. La difficile estimation du bilan humain des guerres et des génocides
Résumé exécutif
Entre février et mars 2025, la Banque Mondiale (BM) a publié 3 rapports d’évaluation portant sur la facture économique de la «guerre» en Ukraine et des «conflits» à Gaza et au Liban. Ces rapports se prêtent à une lecture comparative portant sur leur méthodologie d’évaluation supposée être «standardisée et suffisamment reconnue internationalement» (BM 2025a, p. 52). Un regard croisé offre ainsi un éclairage critique sur la construction politique des évaluations de la BM et, a fortiori, sur leurs multiples instrumentalisations au sein des relations internationales.
Dans les rapports de la BM sur la Palestine, le mot guerre ne figure jamais dans le texte, on y fait exclusivement référence aux «conflits» (conflit de 2023, conflit de 2021, conflit de 2014, etc.). De même, dans les rapports sur le Liban, le mot «guerre» n’apparaît jamais non plus, sauf dans de rares références bibliographiques, et la seule occurrence du mot «Israël» figure dans une référence en note de bas de page. En revanche, dans son évaluation de 2024 portant sur l’Ukraine, la BM mentionne le terme «guerre» 184 fois, dont 4 occurrences se référant explicitement aux impacts des «crimes de guerre» de la Russie (BM 2024c). L’évaluation de 2025 accorde une plus grande place à la nature et à l’intensité des violences liées à une «invasion» (93 occurrences) russe (la Russie est mentionnée au moins 50 fois), en montrant l’aggravation de son bilan en fonction des phases de la guerre, de ses trajectoires et de son intensification (BM 2025c, p. 24-25). «Au-delà des impacts physiques ou financiers, plus facilement quantifiables», le rapport de la BM sur l’Ukraine se propose de fournir «une description qualitative montrant comment la vie des gens a été dramatiquement altérée depuis février 2022»[1] (BM 2025c, p. 10).
Le glissement d’une évaluation en contexte de guerre (comme en Ukraine) à des évaluations en contextes de conflits (comme à Gaza et au Liban) n’est pas uniquement d’ordre sémantique. Il en découle une sélection différente des catégories «observables» à intégrer dans l’évaluation, affectant ainsi la «facture» de la guerre.
Ainsi, le glissement d’une évaluation en temps de guerre à une évaluation en temps de conflit (ou post-conflit) constitue un biais idéologique qui risque de donner une image tronquée du bilan comptable. Plus important, il touche d’emblée au problème de reconnaissance mondiale des droits et des statuts des victimes et risque de transformer l’évaluation en un instrument qui nie les crimes de guerre, a fortiori les génocides, à l’instar des destructions systématiques et intentionnelles des environnements naturels (écocides) ou urbains (urbicides), ou encore des espaces éducatifs (éducides).
La facture de guerre dressée par la BM en Ukraine est fondée sur une approche par les droits des victimes des guerres, car elle intègre, et à juste titre, les droits des victimes de guerre, notamment la prise en charge des blessés de guerre et des familles des vétérans par la sécurité sociale et par les programmes d’assistance, deux dimensions entièrement exclues des rapports sur le Liban et sur Gaza.
Par ailleurs, du fait de la concertation avec l’État, les évaluations de la BM en Ukraine tiennent compte des politiques économiques, sociales et militaires qui viseraient la préservation ou la restauration des droits des victimes, faisant donc place à des mécanismes de reconnaissance et de compensation pour les crimes de guerre, conformément à la décision du Conseil de l’Europe de créer un registre international des dommages causés par la Russie à l’Ukraine, conformément à la résolution CM/Res (2023). Enfin, les rapports de la BM sur l’Ukraine intègrent pleinement dans leurs calculs les coûts liés à la gestion des risques d’explosifs, et même les coûts en termes de ressources humaines pour le réaménagement post-conflit des sols affectés par la guerre.
Mais pour le Liban et Gaza, l’exercice est conduit par la BM en dehors de tout cadre réglementaire et parfois sans concertation avec les autorités locales (comme dans les deux rapports intermédiaires de la BM en 2024), laissant aux évaluateurs la liberté de définir les composantes (à inclure ou à exclure) de l’évaluation.
Ainsi, selon la BM, les impacts environnementaux des guerres au Liban et à Gaza seraient principalement causés par les crises de la gestion des déchets générés par les destructions ou les déplacements des populations. Au Liban, même l’usage du phosphore blanc par l’armée israélienne – avec ses impacts durables sur la santé, sur l’environnement, ou sur la protection sociale – est écarté du rapport, au prétexte que son usage «n’a pas pu être vérifié de manière indépendante et scientifique par la BM» (BM 2024a, p. 14).
Un dernier décalage significatif se trouve dans la place accordée par la BM aux femmes et aux victimes des violences sexuelles. Dans son rapport sur l’Ukraine, les violences basées sur le genre commises par l’armée russe sont explicitement citées comme des crimes de guerre, alors que dans ses rapports sur la Palestine, la BM ne mentionne que les violences commises par les garçons et les hommes palestiniens, en en faisant donc un problème interne à la société palestinienne. Pourtant, les Nations Unies n’hésitent pas à qualifier l’usage systématique et intentionnel des violences sexuelles (contre les hommes et les femmes) et des violences basées sur le genre par l’armée israélienne en Palestine comme crimes contre l’humanité (Nations Unies 2025).
Enfin, l’incertitude sur le bilan des guerres en vies humaines montre toute la différence entre la place mineure accordée par la BM aux sources d’information produites par les autorités publiques en Palestine ou au Liban, et la place prépondérante accordée aux données produites par le gouvernement ukrainien.
En fin d’analyse, les rapports sur le Liban et Gaza excluent un grand nombre de coûts liés à la guerre (les coûts environnementaux des armes non conventionnelles, les risques liés aux explosifs, les coûts de la prise en charge des blessés des guerres et des personnes handicapées, les coûts pour la protection sociale, etc.), des coûts qui sont pourtant inclus dans le rapport sur l’Ukraine. Par conséquent, selon la BM, la majorité de la facture des «conflits», au Liban comme à Gaza, proviendrait des destructions du secteur du logement, alors qu’elles ne représentent que le tiers des coûts de la «guerre» pour l’Ukraine.
À l’avenir, des comparaisons systématiques des évaluations de la BM avec des approches sectorielles détaillées, ancrées dans le terrain et au niveau du sol [ground-level approaches] – à l’image des évaluations du National Center for Natural Hazards & Early Warning du CNRS libanais – sont nécessaires pour contrecarrer l’emprise croissante de la BM sur les évaluations en temps de guerre. Car, avec les mandats d’arrêts de la Cour Pénale Internationale contre des dirigeants russes et israéliens, ces exercices d’évaluation représentent aujourd’hui des enjeux politiques majeurs, portant principalement sur la reconnaissance (ou le déni) de crimes de guerre, de crimes de génocide, et de crimes contre l’humanité, avec probablement des répercussions importantes pour l’avenir du droit international.
Introduction
En mars 2025, la Banque Mondiale (BM) a publié un rapport d’évaluation «finale» des dommages et des pertes, ainsi que des besoins futurs de recouvrement (recovery) et de reconstruction à la suite du « conflit de 2023-2024 qui a affecté le Liban[2] » (BM 2025a, p. 9). Cette évaluation rapide des dommages et des besoins du Liban (Rapid Damage and Need Assessment – ci-après RDNA) s’appuie sur une «méthodologie standard d’évaluation des besoins post-catastrophe » (Post-Disaster Needs Assessment – ci-après PDNA) (BM 2025a, p. 16, 52, 55). S’il est évident que ce rapport porte sur une évaluation économique de l’impact de la guerre avec Israël qui a débuté le 8 octobre 2023, la BM ne donne aucun élément de contexte permettant de comprendre la nature du « conflit », des désastres ou des catastrophes en question. Le mot «guerre» n’apparaît jamais dans le texte, sauf dans de rares références bibliographiques, et la seule occurrence du mot « Israël » figure dans une référence en note de bas de page.
Auparavant, la BM avait publié un premier rapport d’évaluation « intermédiaire» (ou intérim) en novembre 2024, deux semaines avant le cessez-le-feu fragile du 27 novembre 2024 entre Israël et le Liban (Lebanon Interim Damage and Loss Assessment – ci-après DaLA Liban) portant lui aussi sur « l’impact du conflit affectant le Liban» (BM 2024a, p. 5), sans aucune occurrence des termes «guerre» ou « Israël » dans le texte.
À première vue, on pourrait croire que cette absence de contextualisation serait une émanation de la neutralité scientifique d’un rapport qui n’a pas la volonté d’analyser le contexte historique ou politique de la guerre, mais dont l’ambition se limite à un exercice comptable visant à chiffrer monétairement l’impact d’un conflit. Pourtant, le contexte compte. D’un côté, sans cadrage temporel, on voit mal pourquoi l’évaluation de mars 2025 pourrait être considérée comme «finale», donnant lieu à un bilan définitif «dans des contextes post-catastrophe et post-conflit » (BM 2025a, p. 16), alors que les frappes israéliennes au Liban continuent d’ébranler le pays, bien au-delà du cessez-le-feu. De l’autre, le PDNA de 2025 affirme suivre la même méthodologie utilisée par la BM dans son évaluation de l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020 (BM 2020a). Or, on est en droit de douter qu’une invasion militaire puisse s’évaluer post-choc, à la manière d’une explosion, alors que des territoires libanais nouvellement occupés ne sont pas encore évacués par l’armée israélienne. La neutralisation des éléments de contexte par la BM n’aide pas à lever ce doute.
Ces défauts de contextualisation ne sont pas propres aux rapports de la BM sur le Liban. On les retrouve, de manière encore plus réductrice, dans ses rapports sur la Palestine (BM 2024b; 2025b). Ainsi, en février 2025, la BM a publié un rapport d’évaluation intermédiaire sur le « conflit » à Gaza et ses effets de déversement (spillover) en Cisjordanie où il n’est jamais fait mention du terme « guerre » (BM 2025b). En collaboration avec les autorités palestiniennes, la BM y tente le défi d’analyser les effets d’entraînement du « conflit » à Gaza (d’un secteur à un autre, d’un territoire à un autre) sans intégrer dans ses calculs des crimes de guerre pourtant attestés par les agences onusiennes, comme les actes de colonisation ou d’arrestation arbitraires de milliers de Palestiniens[3]. Ce rapport faisait suite à une autre évaluation publiée sans concertation avec les autorités palestiniennes en mars 2024, portant sur les « conflits » à Gaza (où l’on compare le conflit de 2023 aux conflits de 2021 ou de 2014), excluant donc la Cisjordanie (BM 2024b).
Or, les rapports d’évaluation de la BM ne font pas toujours l’économie des éléments de contexte. En s’appuyant sur lecture comparative des rapports de la BM, la présente étude propose de montrer que le cadrage historique, spatiale, politique, voire idéologique, de « l’événement » évalué influence les composantes de l’évaluation, notamment les « comparaisons pré- et post-événement » (pre-/post-event comparisons) (BM 2025a, p. 68), et a fortiori son bilan comptable.
À ce niveau, la comparaison avec les rapports de la BM sur l’Ukraine sera importante pour montrer comment les défauts de cadrage influencent les bilans comptables, même si la méthodologie d’évaluation est supposée être suffisamment standardisée pour permettre de conduire des estimations «bien établies et bien reconnues globalement » et de préparer une réponse coordonnée à l’échelle internationale[4] (BM 2025a, p. 52). En effet, depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie (février 2022), la BM a publié 4 rapports d’évaluation intermédiaire des dommages et des pertes causés par « la guerre russe » et ses « crimes de guerre » (BM 2024c, p. 61, p. 165-166). Le RDNA de 2024 sur l’Ukraine mentionne le terme «guerre» 184 fois, dont 4 occurrences se référant explicitement aux impacts des « crimes de guerre » de la Russie (BM 2024c). Le dernier en date, publié en février 2025, accorde une plus grande place à la nature et à l’intensité des violences liées à une « invasion» (93 occurrences) russe (la Russie est mentionnée au moins 50 fois), en montrant l’aggravation de son bilan en fonction des phases de la guerre, de ses trajectoires et de son intensification (BM 2025c, p. 24-25). «Au-delà des impacts physiques ou financiers, plus facilement quantifiables », la BM propose dans ce rapport de fournir «une description qualitative montrant comment la vie des gens a été dramatiquement altérée depuis février 2022 [5]» (BM 2025c, p. 10).
Aussi, l’ampleur des évaluations de la BM peut différer considérablement d’un contexte à un autre, en dépit de l’usage d’une même méthodologie. Introduite par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies en 1972, la méthodologie d’évaluation des dommages et des pertes a été affinée conjointement par la BM, l’Union européenne (UE) et les Nations Unies (NU), en bénéficiant graduellement des apports des technologies les plus avancées. La collecte de données des évaluations exige ainsi des moyens techniques et financiers qui échappent souvent à de nombreux États – notamment dans des contextes de guerres ou de conflits armés. Au demeurant, si l’assistance technique de la BM est parfois demandée officiellement par les États concernés, l’exercice d’évaluation peut être parfois conduit par la BM et ses partenaires sans concertation avec les autorités publiques. De toute évidence, le contour spatial, temporel ou sectoriel de l’évaluation influence son bilan comptable, mais il reste à comprendre les choix politiques qui président à la construction de telles délimitations
Publiés à quelques mois d’intervalles, les rapports de la BM sur la guerre en Ukraine et les conflits à Gaza et au Liban se prêtent à une lecture comparative qui offre un regard critique sur leur méthodologie d’évaluation, et sur les choix extra-méthodologiques (principalement politiques) conduisant à l’inclusion ou à l’exclusion de certaines composantes (géographiques, temporelles, sectorielles, etc.) de leur bilan comptable.
Sans prétendre contester la pertinence de la méthodologie d’évaluation de la BM ni la validité de ses estimations, une lecture comparative de ces rapports offre un éclairage critique sur leur construction politique et, a fortiori, sur leurs multiples instrumentalisations au sein des relations internationales.
En effet, la qualification de l’événement en cours d’évaluation - et quel que soit le terme utilisé pour désigner cet événement (conflit, violence armée, guerre, invasion, catastrophe, choc, désastre, etc.) - n’est pas une donnée externe à la comptabilisation des dommages et des pertes. Bien au contraire, les hypothèses méthodologiques et les bilans comptables sont influencés par une compréhension préalable, mais tenace, de la nature politique des objets de l’évaluation, même si cette dernière n’est pas clairement explicitée par la BM.
Puisque les rapports de la BM sont sélectifs dans leur cadrage des contextes de l’évaluation, les deux premières sections mettront en perspective les contextes des guerres en Ukraine, en Palestine et au Liban, en lien avec les contextes politiques propres à la préparation et à la construction des rapports d’évaluation. Les sections suivantes (sections 3 à 6) discuteront successivement les différences de traitement que la BM accorde aux violences basées sur le genre, aux secteurs de la santé et de la protection sociale, au secteur public et à la facture environnementale. La dernière section reviendra sur les incertitudes des évaluations de la BM face au bilan humain des guerres et des conflits et sur l’inégale reconnaissance des statuts et des droits des victimes.
1. Les délimitations spatiales et temporelles : les échelles politiques des évaluations
Les rapports d’évaluation de la BM, souvent conduits dans des contextes de guerres en cours, sont soumis aux contraintes d’accès au terrain et s’exposent aux aléas des risques sécuritaires, quand les données collectées peuvent évoluer au gré de l’escalade des violences armées. La BM multiplie ainsi les avertissements méthodologiques en rappelant continuellement les limitations contextuelles, temporelles, techniques, ou topographiques de ses évaluations (BM 2025b, p. 18 ; BM 2025a, p.24).
Théoriquement, un bilan (intermédiaire ou final) permet aux autorités publiques et aux pays donateurs d’estimer (ex ante ou ex post) les coûts (effectifs ou potentiels) et de prioriser la réponse humanitaire, les aides et les efforts de soulagement. En pratique, l’instrumentalisation politique des rapports d’évaluation de la BM est chose habituelle. Certes, la BM souligne elle-même les multiples incertitudes méthodologiques et scientifiques de ses évaluations, afin de se prémunir contre leur exploitation politique. Mais, de toute évidence, ses rapports ont un intérêt majeur pour les États – et au sein des agences interétatiques – malgré (et quelque part, à cause de) leurs limitations méthodologiques.
À des degrés différents, les rapports de la BM s’appuient sur une méthodologie commune, dite évaluation des dommages et des pertes (DaLA), et la BM leur intègre parfois une estimation rapide des besoins (RDNA). Les méthodologies DaLA et RDNA sont dites «intermédiaires» (ou intérim) quand elles portent sur l’évaluation d’événements «en cours», alors qu’une évaluation finale donne un bilan définitif en comparant les coûts pré- et post-conflit.
Enfin, qu’elle soit intermédiaire ou finale, l’évaluation emploie des principes de comptabilité pour estimer des dommages [damages] physiques et des pertes [losses] économiques. Les dommages renvoient aux coûts des destructions partielles ou totales des actifs dans différents secteurs, en les comparant à leur valeur de remplacement (d’avant choc). Les pertes sont des variations dans les flux monétaires ou des manques à gagner en termes de revenus futurs.
Les différences entre une évaluation finale (comme en mars 2025 au Liban) et une évaluation intermédiaire (le DaLA Liban ou les RDNA en Palestine et en Ukraine) ne se limitent pas à l’échelle temporelle de l’événement analysé (achevé vs inachevé; ex ante vs ex post). En effet, la temporalisation et la spatialisation des évaluations se fondent sur des postulats politiques (et idéologiques) que la BM n’explicite jamais.
Ainsi, l’évaluation intermédiaire du DaLA Liban estime les pertes futures sur les 12 prochains mois dans les différents secteurs évalués. En revanche, dans les 4 évaluations intermédiaires en Ukraine, cette estimation des pertes futures est projetée sur 18 mois (au lieu de 12 mois comme au Liban).
De même, l’évaluation des besoins de relèvement, de recouvrement (recovery) et de reconstruction calcule les coûts de restauration, des infrastructures et des services, à leur niveau d’avant choc, en incluant une prime pour mieux reconstruire (build-back-better premium). Si les besoins au Liban sont estimés selon trois échelles temporelles qui s’étendent jusqu’en 2030 (des besoins immédiats en 2025, des besoins à court terme à l’horizon de 2027, et des besoins à moyen terme pour la période 2028-2030), les estimations des besoins en Ukraine s’étendent généralement sur 10 ans. Quant au IRDNA de 2025 sur la Palestine, l’estimation des besoins de moyen à long terme s’étale sur un horizon de 5 à 8 ans (BM 2025b, p. 25).
Il est important de souligner ces décalages temporels dans le calcul comptable des pertes et des besoins car la BM affirme suivre partout la même méthodologie, et elle rappelle souvent que chaque nouvel exercice comptable se nourrit des précédents, que l’évaluation faite dans un pays à un moment donné sert d’appui aux évaluations futures dans d’autres contextes de conflits ou de guerres similaires. Ainsi, la BM affirme que l’évaluation finale du RDNA libanais de mars 2025 s’appuie sur des proxys tirés de l’évaluation à Gaza ou en Ukraine (BM 2025a, p. 54), tout comme elle reprend (ou actualise) un grand nombre de résultats tirés de l’évaluation intermédiaire des dommages et des pertes (le DaLA Liban) de novembre 2024 (BM 2025a, p.16). De même, cette dernière s’appuie elle aussi sur la méthodologie «utilisée avec succès dans de nombreux pays,» et dans «d’autres contextes similaires,» et intègre ainsi des «indicateurs proxys d’autres pays et/ou d’évaluations similaires» comme à Gaza et en Ukraine (BM 2024a, p. 17-18). Toutefois, sans contextualisation, on voit mal quelles similitudes la BM a dressées entre la guerre en Ukraine et les conflits à Gaza et au Liban. Plus important, en absence de contextualisation des données, il n’est pas possible de faire sens des estimations comptables prenant la forme «d’extrapolations et de proxys dérivés de pays et/ou de contextes similaires,» comme l’affirme la BM, d’autant plus que ses chiffres sont brassés à partir de méthodes aussi variées que les entretiens qualitatifs, les triangulations de données de la presse, la collecte de données avérées par des images satellites, par imagerie hyperspectrale ou radar à synthèse d’ouverture, et la production de données de l’intelligence artificielle raffinées manuellement.
Ainsi, avant de procéder à une lecture comparative des rapports de la BM, un cadrage spatial et temporel s’impose dans un premier temps, en analysant notamment le contexte des événements évalués (la guerre en Ukraine et les conflits en Palestine et au Liban) en lien avec le contexte de construction des rapports d’évaluation. Ce recadrage est d’autant plus important que les bilans comptables continuent de s’alourdir au moment où nous écrivons ces lignes, quand un accord entre la Russie et l’Ukraine peine à voir le jour, et que les frappes israéliennes au Liban et en Palestine se renouvellent et s’étendent bien au-delà des accords fragiles de cessez-le-feu (respectivement, le 27 novembre 2024 et le 19 janvier 2025).
2. Des évaluations dans des contextes de guerres ou de conflits
L’invasion russe de l’Ukraine a commencé le 24 février 2022. Dès les premiers mois, la BM a lancé ses travaux d’évaluation rapide des dommages et des pertes, et d’évaluation intermédiaire des besoins (RDNA), avec deux premières publications au 3e et au 12e mois de la guerre. Un troisième RDNA a été publié en février 2024 (BM 2024c). Le dernier, publié en février 2025, couvre toute la période allant de février 2022 à décembre 2024 (BM 2025c). Préparés conjointement avec l’UE et les NU, partenaires habituels des évaluations de la BM, ces rapports consacrent le gouvernement ukrainien comme partenaire dans la préparation et l’élaboration des évaluations (BM 2025c, p. 9) en citant les contributions des différents ministères qui ont participé à la production ou à la vérification des données, à l’instar du Registry of Damaged and Destroyed Property du gouvernement dont «le mandat est d’enregistrer ou de vérifier les actifs endommagés[6] » (BM, 2025c, p. 93). Enfin, le gouvernement ukrainien est considéré comme le principal destinataire de ces rapports. En effet, chaque rapport est généralement présenté par la BM lors d’une conférence publique devant les autorités ukrainiennes, la Commission européenne et d’autres pays donateurs, dans le cadre d’un événement de lancement (launch event) sur lequel nous reviendrons longuement plus loin dans cette étude. Ces événements jouent un rôle crucial dans la reconnaissance internationale des dommages et des pertes subis par l’Ukraine, et constituent en même temps un moment clé pour aider le gouvernement ukrainien à lever les fonds nécessaires à ses efforts de guerre. Comme l’affirme le ministère des Finances ukrainien dans l’annonce de cet événement sur son site, «le rapport détermine le montant des fonds nécessaires au redressement et à la reconstruction […] et, en 2024, 28 accords totalisant 31 milliards d’USD ont été signés, dont 22,9 milliards d’USD en subventions, et des millions d’Ukrainiens ont reçu du soutien à travers cette coopération entre l’Ukraine et la Banque Mondiale [7] ».
Ensuite, le 7 octobre 2023, l’opération meurtrière du Hamas, dite «déluge d’Al-Aqsa » a coûté la vie à près de 1 139 Israéliens, avec des prises d’otages touchant 251 personnes, et quelques 2000 personnes admises aux urgences, dont 630 ont été hospitalisées (56% de militaires et 44% de civils ou de policiers) (Goldman et al. 2024). En représailles aux attaques du Hamas, et au soutien armé apporté par le Hezbollah dès le 8 octobre 2023, Israël a répondu par des guerres de grande ampleur au Liban et en Palestine, avec des répercussions militaires à l’échelle de toute la région (impliquant à différents degrés l’Irak, l’Iran, le Yémen et la Syrie).
Le 29 mars 2024, la BM publie un premier rapport d’évaluation intermédiaire sur le «conflit» à Gaza, sans que les autorités palestiniennes soient impliquées comme partenaires dans l’évaluation. Le terme guerre [war] n’y apparaît jamais, la BM parlant exclusivement de «conflits» [conflict], terme mentionné 91 fois dans un rapport de 32 pages.
Le rapport de la BM sur Gaza est particulièrement lacunaire, car il n’intègre pas la totalité des territoires du «conflit,» excluant donc les actes de guerre perpétrés dans l’ensemble des territoires palestiniens en dehors de Gaza, notamment les actes de colonisations en Cisjordanie. La BM y souligne à plusieurs reprises le besoin de conduire une nouvelle évaluation incluant la Cisjordanie, «quand la situation sécuritaire le permettra» (BM 2024b, p. 4; p.21; p.24). Ainsi, en février 2025, la BM publie en effet un nouveau rapport d’évaluation intermédiaire IRDNA sur la guerre à Gaza et ses déversements en Cisjordanie (BM 2025b). À l’instar de son prédécesseur, le nouveau rapport ne mentionne pas les questions de confiscation des terres, d’expropriation, de destruction méthodologique des sols arables, encore moins les actes d’expansion des colonies en Cisjordanie, pourtant confirmés et condamnés «comme crimes de guerre» par une grande partie de la communauté internationale, y compris par la France ou l’Espagne[8]. Par conséquent, selon la BM, le total des dommages et des pertes du secteur foncier palestinien s’élèverait uniquement à 130 millions d’USD selon une évaluation qui n’inclut pas «l’accès à la terre» dans son calcul comptable. Car, «compte tenu de la perte de la documentation et la perte potentielle de propriété, il existe une incertitude de long terme sur le régime foncier et les droits de propriété», la BM ne manquant pas de rappeler qu’avant la guerre seulement 38% des Palestiniens avaient accès à des documents légaux prouvant leur droit de propriété[9] (BM 2025c, p. 53). Ainsi, au lieu d’intégrer dans ses calculs les coûts liés aux nouvelles confiscations des terres palestiniennes par la colonisation israélienne, en accélération depuis le 7 octobre 2023, la BM les évacue tout simplement en raison d’une incertitude méthodologique qu’on n’explicite pas, et qui ne pourrait d’ailleurs pas être explicitée sans revenir sur le contexte spécifique d’une colonisation de longue date.
Enfin, au moment où la guerre israélienne au Liban entrait dans son quatorzième mois[10], la BM publie un premier rapport intermédiaire (DaLA Liban) sans l’implication des autorités libanaises. Si les termes «guerre» [war] et «Israël» ne figurent jamais dans le texte, mais uniquement dans des titres d’articles cités en bibliographie, le terme conflit [conflict] est utilisé 103 fois dans un rapport de 40 pages. Le rapport prend comme date de début le 8 octobre 2023, et deux dates limites : le 27 septembre 2024 pour l’agriculture et l’environnement et le 28 octobre 2024 pour les autres secteurs-clés (BM 2024a, p. 5). En mars 2025, la Banque Mondiale (BM) publie un second rapport d’évaluation, finale cette fois-ci, des dommages et pertes du «conflit» au Liban, en lui intégrant une évaluation des besoins de recouvrement (recovery) et de reconstruction du pays, suivant une méthodologie d’évaluation post-conflit (BM 2025a, p. 16). Selon la BM, ce rapport de 2025 est préparé à la demande des autorités libanaises et en collaboration avec le Conseil national de la recherche scientifique libanais (CNRS-L) (BM 2025a, p. 9).
Ainsi, les rapports de la BM en Ukraine portent explicitement sur l’évaluation des crimes de guerre commis par la Russie, tels qu’ils sont recensés et vérifiés par les autorités ukrainiennes. Au Liban et en Palestine, les rapports de la BM portent sur des conflits décontextualisés qui ne laissent aucune place aux guerres, encore moins aux crimes de guerre. Cette différence n’est pas purement formelle ; comme nous le montrerons par la suite, les rapports de la BM diffèrent non seulement par la place accordée aux autorités publiques, et leurs sources d’information, mais aussi par le nombre des secteurs inclus dans les évaluations, par les composantes évaluées dans chaque secteur, et par l’étendue spatiale et temporelle des exercices comptables.
3. Le statut des victimes de guerres : focus sur les violences basées sur le genre
De toute évidence, une évaluation portant sur un «conflit » comme à Gaza ou au Liban, pourra difficilement intégrer les coûts liés aux «crimes de guerre » comme c’est le cas dans les rapports sur l’Ukraine. Ainsi, les 4 rapports sur l’Ukraine incluent de manière holistique l’ensemble des dégâts et des pertes d’un pays en guerre, y compris dans les zones ou secteurs relativement épargnés par l’invasion russe. De même, ces rapports intègrent à chaque fois dans leurs calculs l’impact de «l’invasion russe» sur les civils et les militaires ukrainiens, ainsi que les coûts encourus par l’État ukrainien dans ses efforts de guerre, dans ses besoins de réarmement ou dans ses efforts de soulagement des populations affectées par la guerre. Les rapports intègrent ainsi (et à juste titre) les coûts liés aux crimes de guerre de la Russie, notamment les déportations ou les déplacements forcés des Ukrainiens (des femmes et surtout des enfants) en Russie ou en Biélorussie, comme documentés par le gouvernement ukrainien. Ainsi, les rapports sur l’Ukraine adoptent une démarche plus ambitieuse que la simple évaluation des dommages et des pertes.
Préparés en concertation avec le gouvernement ukrainien et en s’appuyant sur ses données et sur ses propres sources de vérification des données, ils proposent explicitement d’évaluer les crimes de guerre commis par l’invasion russe, dans une perspective de faire valoir les droits des populations et des autorités ukrainiennes «victimes des guerres». Par exemple, l’évaluation des violences basées sur le genre en Ukraine est non seulement fondée sur une approche par les droits humains, mais intègre également la dénonciation des «violences sexuelles commises par les soldats russes» (BM 2025c, p. 90), ce qui conduit à l’inclusion des «violences sexuelles reliées au conflit et la traite des êtres humains» au sein des composantes des violences basées sur le genre (BM 2025c, p. 40).
Mais le rapport sur la Palestine reste étrangement silencieux sur les violences sexuelles liées à la guerre [conflict-related sexual violence]. Les seules mentions des violences liées au genre sont traitées soit comme des sous-produits liés à la vulnérabilité accrue et intersectionnelle des femmes en temps de conflit, soit comme des résultantes des violences traditionnellement perpétrées par les hommes palestiniens contre les femmes. Ainsi, selon la BM, les violences basées sur le genre en Palestine seraient avant tout une affaire interne, propre aux Palestiniens entre eux, qui s’exacerbe en temps de conflits «avec la moitié des femmes mariées soumises à des abus» (BM 2025b, p. 56). Pas étonnant que les recommandations de la BM se concentrent donc principalement sur la nécessité d’organiser des plans de prévention et des sessions de sensibilisation aux violences basées sur le genre, ciblant surtout les hommes et les garçons palestiniens (BM 2025b, p. 57). Puisque le problème est principalement considéré comme interne à la société palestinienne, la BM pense que «le recouvrement offrira l’occasion de remédier aux inégalités systémiques et de garantir que les femmes et les filles soient au cœur des efforts de reconstruction» (BM 2025b, p. 57). Quant aux violences sexuelles que la guerre israélienne impose aux hommes palestiniens et aux femmes palestiniennes, on n’en trouve nulle mention dans les rapports de la BM. Pourtant, l’usage des violences sexuelles sur les femmes palestiniennes (et dans une moindre mesure sur les hommes) a été extrêmement bien documenté, au point qu’un rapport d’enquête récent des Nations Unies conclut qu’il constitue un crime contre l’humanité : «La Commission conclut, sur la base de motifs raisonnables, que les cas de femmes et de filles directement ciblées par des membres de la Force de défense d’Israël (FDI) constituent des violations du droit à la vie. De plus, ces actes constituent un crime contre l’humanité» (Nations Unies 2025, p. 37).
La place inégale accordée aux femmes ukrainiennes et palestiniennes victimes de violences sexuelles dans les rapports de la BM est très éclairante sur ce glissement d’une évaluation en temps de guerre, en Ukraine, à celle d’une « crise humanitaire extrêmement sévère[11] » à Gaza (BM 2024b, p. 1). Plutôt que d’être considérées comme les victimes d’une série de guerres récurrentes, donc d’abord comme des victimes de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité, les Palestiniennes sont plutôt décrites comme des victimes de « crises humanitaires» aggravées aujourd’hui en temps de « conflit » (BM 2024b, p. 1-2 & p. 18), quand « le risque des violences basées sur le genre est exacerbé par le déplacement interne massif» (BM 2025c, p. 19).
Les secteurs de la santé et de la protection sociale offrent à leur tour une illustration de ce glissement d’une évaluation en contexte de guerre (comme en Ukraine) à des évaluations en contextes de conflits et de crises humanitaires (comme à Gaza et au Liban). La différence n’est pas uniquement d’ordre sémantique ; il en découle une sélection différente des catégories «observables » à intégrer dans l’évaluation, affectant ainsi le bilan comptable.
4. Focus sur la santé et la protection sociale en temps de guerres ou de conflits
En partant de l’hypothèse de la future adhésion de l’Ukraine à l’UE, la BM intègre dans ses évaluations les besoins futurs d’une protection sociale qui serait conforme aux normes européennes. Ainsi, la facture de guerre dressée par la BM en Ukraine intègre les coûts pour la protection sociale, notamment ceux de la prise en charge des blessés de guerre par la sécurité sociale et ceux des programmes d’assistance aux populations vulnérables. Ces deux dimensions sont entièrement exclues des rapports de 2024 sur le Liban et sur Gaza. Dans le Gaza interim Damage assessment, cette exclusion résulte – par construction – de la limitation de l’évaluation aux seuls dommages, sans les pertes économiques (BM 2024b). Mais, comment expliquer l’exclusion des pertes de la protection sociale des rapports de la BM sur le Liban?
En Ukraine, les seules pertes de la protection sociale ont été estimées en 2025 à plus de 14,4 milliards d’USD par la BM, contre 19,6 milliards pour le secteur de la santé (BM 2025c, p. 38), montant qui dépasse le total cumulé des dommages et des pertes du Liban, tous secteurs confondus, estimé à 14 milliards d’USD (BM 2025a, p. 9). Certes, les échelles des destructions entre l’Ukraine et le Liban ne sont pas comparables. Mais ce qui est véritablement alarmant dans cette comparaison, ce n’est pas tant la disproportion des coûts économiques, mais plutôt la décision, éminemment politique, d’écarter entièrement l’ensemble du secteur de la protection sociale libanais. Pourtant, en temps de guerre, même dans un pays comme le Liban où l’État est faiblement protecteur, les pertes de la protection sociale sont loin d’être marginales. Comment expliquer donc que la protection sociale soit exclue de l’évaluation de la guerre israélienne au Liban, alors que la prise en charge des victimes de guerre a pesé lourdement sur les finances de l’État ?
D’un côté, dans son PDNA de 2025, la BM affirme que les secteurs inclus dans son évaluation ont été imposés par le gouvernement libanais lui-même (BM 2025a). De l’autre, le DaLA Liban de 2024 – qui, rappelons-le, n’était pas commandé par le gouvernement – n’incluait pas non plus le secteur de la protection sociale (BM 2024a).
Les deux rapports sur le Liban excluent de leur champ le secteur de la protection sociale. En revanche, la couverture des blessés ou à l’accès au soin pour les patients déplacés, notamment les non-assurés, ainsi que les coûts liés aux mécanismes de restauration de ces services ont été partiellement intégrés dans le secteur de la santé libanais (BM 2025a, p. 39)
Conjointement, les dommages et les pertes du secteur de la santé au Liban sont estimés par la BM à 412 millions d’USD (dont 74 millions d’USD pour les dommages et 338 millions d’USD pour les pertes) en novembre 2024. Ils sont estimés à 908 millions dans l’évaluation finale de mars 2025, dont 208 millions pour les dommages et 700 millions pour les pertes. Dans les deux rapports, l’évaluation des dommages dans le secteur de la santé se limite aux destructions physiques des structures de soin. Quant aux pertes, elles résultent de l’augmentation des coûts des soins de santé supplémentaires pour les blessures et les maladies dues au conflit et aux déplacements (45 millions d’USD en 2024 contre 51 millions d’USD en 2025), de la diminution des revenus provenant des installations inopérantes (201 millions d’USD en 2024 contre 605 millions d’USD en 2025) et de la disponibilité réduite du personnel de santé pour fournir des soins médicaux appropriés, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité et de la morbidité (91 millions d’USD en 2024 contre 44 millions d’USD) (BM 2024a, p. 11; BM 2025a, p. 39). L’évaluation finale conserve donc les mêmes hypothèses d’analyse donnant toutefois une facture plus lourde.
Ce maigre bilan final des dommages et des pertes du secteur de la santé devrait être mis en perspective avec celui de l’explosion du port de Beyrouth en 2020, quand la BM avait estimé les pertes du secteur de la santé à un coût variant entre 200 et 245 millions d’USD, les dommages entre 95 et 115 millions d’USD (BM 2020a, p. 43), et les besoins de la protection sociale à un niveau qui dépasse de moitié celui du secteur de la santé (BM 2020a, p. 46). Pourtant, le nombre de morts en novembre 2024 était au moins 15 fois supérieur à celui de l’explosion du port en 2020, et, à elle seule, l’attaque des beepers/pagers du 19 septembre 2024 avait généré des milliers de personnes nouvellement handicapées. De même, la prise en charge des blessés de guerre (incluant les blessés des attaques des beepers/pagers) a été entièrement assurée par le ministère de la Santé, aussi bien dans les hôpitaux publics que privés. Par ailleurs, en 2025, on atteint un niveau de destruction des structures de santé jamais connu dans l’histoire du pays, avec 298 structures médicales entièrement détruites (dont 1 hôpital, 121 cliniques dentaires, 60 pharmacies et 34 centres de développement social) et 587 endommagées (dont 39 hôpitaux) (BM 2025a, p. 39).
Comme souligné auparavant, il ne s’agit pas ici de contester les méthodes d’estimation de la BM, et encore moins la validité de leurs chiffres (le bilan comptable), mais plutôt d’attirer l’attention sur les choix politiques qui président à leurs constructions, en l’occurrence le choix éminemment politique d’inclure (en 2020) ou d’exclure (en 2024 et 2025) les pertes encourues par la sécurité sociale et les autres structures étatiques de protection sociale au Liban. Plus généralement, contrairement aux rapports sur l’Ukraine, les évaluations de la BM au Liban n’intègrent pas l’impact de la guerre israélienne sur la santé publique, ni sur les finances de l’État libanais. Avec lui, c’est le secteur public libanais, avec ses dommages et ses pertes, ou encore ses besoins de financement futurs, que les rapports de la BM semblent ainsi escamoter. Par conséquent, les seuls dommages, pertes ou besoins du secteur public du PDNA de 2025 se limitent à ceux des municipalités et des services publics.
Aussi, l’écart dans le traitement réservé aux secteurs de la santé et de la protection sociale en Ukraine, au Liban ou à Gaza ne peut pas être uniquement imputé à des limitations méthodologiques. Comme le montre la section suivante, il relève plutôt d’un parti pris, idéologique et politique, lié à la place que la BM accorde aux États concernés dans ses différents rapports d’évaluation, ce qui influence le statut et les droits des victimes, ainsi que le bilan comptable de l’exercice d’évaluation.
5. Le droit de l’État comme préalable à la construction du droit des victimes
Après l’invasion russe, le Conseil de l’Europe a annoncé la création d’un registre international des dommages causés par la Russie à l’Ukraine, conformément à la résolution CM/Res (2023). Ainsi, «la procédure et les méthodes d’évaluation des dommages et des pertes dues à la guerre russe sont définies dans un certain nombre de documents réglementaires» (Zhuk et al. 2023, p. 204). Mais pour le Liban et Gaza, l’exercice est conduit par la BM en dehors de tout cadre réglementaire, et parfois sans concertation avec les autorités locales comme dans le cas des évaluations de 2024, ce qui laisse aux évaluateurs de la BM la liberté de définir les composantes (à inclure ou à exclure) de l’évaluation.
De même, du fait de la concertation avec l’État, les évaluations de la BM en Ukraine sont fondées sur une approche par les droits, tenant compte des politiques économiques, sociales et militaires du gouvernement ukrainien visant la préservation ou la restauration des droits des victimes. D’un côté, l’évaluation intègre les coûts de la guerre que le ministère de la Défense subit en luttant contre l’invasion russe, ou dans ses tentatives de porter secours aux civils. De l’autre, la BM mesure les impacts de la guerre en Ukraine en termes de droits humains, en intégrant (et à juste titre) deux catégories importantes : le droit des vétérans ukrainiens et de leurs familles, et l’impact en termes de protection des enfants, notamment dans le cadre de déportations forcées, quand «19 546 enfants ukrainiens ont été déportés ou déplacés de force vers la Russie» (BM 2025c, p. 24).
En revanche, les évaluations de la BM au Liban ou à Gaza n’intègrent pas les coûts liés aux droits et aux protections des victimes. Le mot «droit» n’apparaît jamais dans le rapport sur le Liban, alors que le rapport de 2024 sur l’Ukraine le mentionne au moins une trentaine de fois (BM 2024c). Bien que l’armée libanaise ait subi des pertes économiques et humaines, les rapports de la BM ne comptabilisent pas les coûts liés aux efforts de guerre (ni ceux du ministère de la Défense, et encore moins ceux du Hezbollah). Même les dommages et pertes subis par les institutions non militaires proches du Hezbollah (comme Al-Kard Al-Hassan, l’une des principales institutions financières non bancaires au Liban, systématiquement ciblée par Israël) n’entrent pas dans les calculs. Au Liban et en Palestine, les vétérans et leurs familles restent hors champ, tout comme les prisonniers de guerre.
Enfin, les rapports sur l’Ukraine sont discutés et validés par le gouvernement ukrainien, car ils jouent un rôle important dans les négociations multilatérales portant sur les mécanismes de l’aide internationale, humanitaire et, surtout, militaire. Reconnues dans leur statut de victimes de guerre, les populations et les institutions ukrainiennes subissent des dommages et des pertes qui se rattachent à un «droit à la réparation». Lors d’une présentation conjointe du RDNA-3, organisée en février 2024 par la BM et le gouvernement ukrainien, le Premier ministre Denys Shmyhal se félicitait que le rapport de la BM dévoile des mécanismes préliminaires de compensation pour l’Ukraine (e.g. le blocage des actifs russes, notamment dans les filiales des banques russes en Ukraine) et il affirme que «les résultats du RDNA-3 contribueront à la mise en œuvre d’un programme de facilité pour l’Ukraine, qui a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l’UE et qui prévoit l’allocation de 50 milliards d’euros sur 4 ans[12] »
Certes, les rapports de la BM n’ont pas vocation à constituer en soi des documents de preuves donnant lieu à des droits ou des compensations[13]. Toutefois, il en découle une différence catégorielle dans la reconnaissance du statut des victimes et des droits associés à leurs protections.
Ainsi, en Ukraine, l’encadrement juridique des évaluations par la Commission européenne conduit à l’établissement d’un registre international des «dommages et des pertes» qui permettra de faire valoir, pour des générations à venir, le droit du peuple ukrainien face aux atrocités des «crimes de guerre» causés par l’invasion russe, au premier rang desquels la BM cite la déportation illégale de populations ukrainiennes ou la privation de liberté dans les zones occupées[14] (BM 2024c, p. 61), tout comme les coûts causés par la mort des journalistes ukrainiens et les pertes des secteurs des médias et de la communication. Et pour répondre à ce besoin, le rapport d’évaluation de la BM en Ukraine va jusqu’à évaluer les coûts du réarmement de l’Ukraine, ainsi que les coûts supportés par les administrations (notamment le ministère de la Justice) dans leurs tentatives d’investigation ou de documentation des crimes de guerre (BM 2024c, p. 165)[15]
Aussi, la prétendue neutralité des hypothèses méthodologiques ne doit pas cacher la fonctionnalité de ces rapports d’évaluation, qui sont des instruments au service des négociations multilatérales et des relations internationales. Non seulement les rapports de la BM influencent la place de l’État au sein des mécanismes de l’aide internationale, mais, en outre, ils touchent d’emblée au problème de reconnaissance mondiale des droits et des statuts des victimes. Comment, par exemple, faire valoir les droits liés aux crimes de guerre, aux génocides et aux crimes contre l’humanité à Gaza, quand l’évaluation de la BM porte uniquement sur l’impact d’un «conflit» dont le bilan se prête à une simple comparaison quantitative (monétaire) avec les «conflits de 2014» et les «conflits de 2021»? D’un côté, ce biais idéologique donne une image tronquée du bilan comptable, car les catégories d’analyse influencent les objets «observables» qu’on prétend mesurer. De l’autre, il risque de transformer l’évaluation en un instrument qui nie les crimes de guerre (a fortiori les génocides), comme le montre par exemple le risque de nier les génocides écologiques de la guerre.
6. Les incertitudes environnementales de la BM au Liban et à Gaza
L’inclusion et l’exclusion de certains désastres environnementaux liés à la guerre, et leurs impacts futurs sur les vies humaines, offrent une autre illustration de la comptabilisation sélective des dommages et des pertes par la BM, et par extension du risque de déni des génocides, notamment écologiques.
Ainsi, les rapports de la BM sur l’Ukraine intègrent pleinement dans leurs calculs les coûts liés à la gestion des risques d’explosifs, et même les coûts en termes de ressources humaines pour le réaménagement post-conflit des sols affectés par la guerre. En revanche, les impacts environnementaux des guerres au Liban et à Gaza seraient principalement causés par les crises de la gestion des déchets générés par les destructions ou les déplacements des populations. Ainsi, en 2024, le DaLA Liban montrait que «l’environnement, à travers la dégradation des ressources naturelles et l’impact sur la gestion des déchets solides, a subi 221 millions de dollars de dommages, et des pertes estimées à 214 millions de dollars» (BM 2024a, p. 5). L’évaluation finale de 2025 conserve les mêmes postulats, donnant toutefois un bilan nettement plus lourd, avec des dommages estimés à 512 millions d’USD et des pertes de 790 millions d’USD (BM 2025a, p. 36).
De même, selon l’évaluation intermédiaire de 2024 à Gaza, la facture environnementale, limitée par construction aux seuls dommages (sans les pertes), s’élevait à 411 millions d’USD, en raison des dommages environnementaux «affectant négativement des biens physiques tels que les zones côtières, l’eau, les sols, les champs agricoles et la réserve naturelle de Wadi Gaza, ainsi que des services écosystémiques vitaux» (BM 2024b, p. 16). Dans l’évaluation plus récente de 2025, la facture environnementale est paradoxalement bien plus limitée, donnant des dommages de l’ordre de 92 millions d’USD et des pertes de 165 millions d’USD. Inutile de chercher à comprendre comment cette facture s’est amoindrie entre les deux temps de l’évaluation, surtout quand la BM nous rappelle que « les bombardements incessants de bâtiments civils ont généré un volume immense de débris (entre 41 et 47 millions de tonnes à ce jour) et des contaminants provenant de résidus d’explosifs sont rejetés dans l’environnement » (BM 2025b, p. 50).
Maigre bilan pour les dégâts environnementaux générés par des dizaines de milliers de tonnes d’explosifs utilisés par l’armée israélienne, et par les destructions systématiques des sols que certains experts qualifient d’un véritable génocide écologique (écocide)[16].
Ainsi, les rapports de la BM sur Gaza et le Liban excluent entièrement l’impact économique et environnemental des armes non conventionnelles. Aussi, leurs coûts actuels ou futurs pour l’environnement ou la santé publique n’apparaissent tout simplement pas dans la comptabilité de la BM. Dans le DaLA Liban de 2024, même l’usage du phosphore blanc par l’armée israélienne – avec ses impacts durables sur la santé, sur l’environnement, ou sur la protection sociale – est écarté du rapport, au prétexte que son usage «n’a pas pu être vérifié de manière indépendante et scientifique par la BM[17] […] ni par aucun autre enquêteur international indépendant» (BM 2024a, p. 14), et le rapport de 2025 ne les mentionne même plus.
Pourtant, le gouvernement libanais et le CNRS-L publient régulièrement, et depuis plus d’un an, des rapports scientifiques sur les dégâts environnementaux causés par la guerre (la géolocalisation des attaques israéliennes, leur nombre et leur intensité, leur ciblage systématique des ressources naturelles, notamment l’eau, etc.) montrant le lieu et le temps exact de l’usage des armes non conventionnelles incluant le phosphore blanc.
Par ailleurs, le National Center for Natural Hazards & Early Warning (NCNHEW) du CNRS-L, tout comme la carte interactive développée par le centre de recherche indépendant Public Works Studio, effectuent une veille scientifique des impacts environnementaux de la guerre attestant de l’usage prolifique du phosphore blanc[18], les deux sources locales étant concordantes sur la géolocalisation des attaques au phosphore blanc tout au long des villages frontaliers.
Par ailleurs, l’usage du phosphore blanc a été attesté par des sources internationales indépendantes, contrairement aux prétendues réserves de la BM. En effet, Human Rights Watch[19] et Amnesty International[20] ont bien documenté l’usage du phosphore blanc le long des frontières libanaises, et un rapport du mois d’août 2024 de l’ESCWA avec UN Habitat affirmait que «l’utilisation de bombes au phosphore et incendiaires a dévasté l’agriculture dans le sud du Liban, détruisant des terres agricoles, du bétail et des infrastructures» (ESCWA 2024, p. 2). On se demande alors quelles autres sources d’enquête internationale indépendante auraient été nécessaires pour que la BM puisse intégrer les dommages et pertes liés à l’usage du phosphore blanc, que les télévisions du monde entier ont pourtant bien retransmis.
Enfin, il est étonnant que ces dégâts environnementaux des armes non-conventionnelles ne soient pas intégrés par la suite au rapport final de la BM en 2025, malgré la collaboration du CNRS-L et du NCNHEW qui les a bien documentés (CNRS & NCNHEW 2024, p.38). Cela dit, c’est l’incertitude sur le bilan des guerres en vies humaines qui montre toute la différence entre la place mineure accordée par la BM aux sources d’information produites par les autorités publiques en Palestine ou au Liban, et la place prépondérante accordée aux données produites par le gouvernement ukrainien.
7. La difficile estimation du bilan humain des guerres et des génocides
Si les épidémiologistes tentent de mesurer ou de catégoriser les pertes humaines en temps de guerres et de post-guerre, les économistes de la BM proposent de chiffrer leurs coûts monétaires. Or, la comptabilisation du nombre de victimes renvoie à plusieurs incertitudes. Comment comptabiliser le nombre officiel des victimes «civiles» directement tuées ou blessées par la guerre? Comment distinguer entre les morts civils et non civils? Comment comptabiliser le nombre de personnes indirectement tuées par la guerre (en raison des maladies, de la pollution, des épidémies, de la malnutrition, etc.), et dont le nombre dépasse souvent celui des victimes directes ?
En s’appuyant sur une revue systématique de dizaines d’enquêtes menées dans des pays touchés par des guerres, le «Global Burden of Armed Violence », rapport issu de la Déclaration de Genève de 2008, montre que le nombre de décès indirects varie généralement de 3 à 15 morts indirectes pour chaque personne civile décédée directement pendant une guerre. Une grande partie de ces décès pourrait être imputée à des violences armées post-guerre, avec «un risque de retomber dans la guerre qui est compris entre 20% et 25% des cas » (Déclaration de Genève, 2008, p. 4-5).
En Ukraine, comme à Gaza et au Liban, le nombre des décès directement ou indirectement en lien avec la guerre est toujours en augmentation. Les victimes les plus vulnérables (comme les personnes handicapées par la guerre, les personnes âgées, les orphelins, ou les femmes, etc.) sont généralement les plus exposées aux risques de violences post-choc, comme le souligne la BM dans son rapport sur l’Ukraine (BM 2024c).
Mais, dans son rapport de 2024 sur Gaza, la BM ne s’engage pas sur le bilan humain du « conflit de 2023-2024,» en affirmant que « les Nations Unies ne sont actuellement pas en mesure de vérifier les chiffres des victimes publiés par le ministère de la Santé de Gaza» (BM 2024b, p. 1). Pourtant, ces derniers sont corroborés par un grand nombre d’analyses épidémiologiques indépendantes qui montrent qu’elles sont conformes aux données des NU et de son Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Une comparaison systématique des deux sources, publiée dans le Lancet, conclut même à une «qualité raisonnable des données » du ministère de la Santé, montrant que les allégations de fabrication de chiffres sont invraisemblables, étant donné que les chiffres officiels sous-estiment le nombre effectif de Palestiniens directement et indirectement tués par la guerre (Jamaluddine et al. 2023, p. 2189). Par ailleurs, un autre article du Lancet corrobore cette concordance entre les chiffres des NU et du ministère de la Santé, donnant à la date du 10 mai 2024 un bilan humain provisoire de 35091 décès directs à Gaza (dont 30% de cadavres non identifiés). Avec des hypothèses d’estimation des plus conservatrices (4 morts indirectes pour chaque civil décédé directement), les auteurs estiment que le nombre total des personnes tuées directement ou indirectement par la guerre s’élèverait à 186000 morts, représentant 7,9% de la population de Gaza (Khatib et al. 2024).
À l’avenir, les évaluations ex post du fardeau économique des guerres doivent donc garder à l’esprit le lien entre les dommages et les pertes encourus en temps de guerre et les bilans humains dans la période post-guerre. Si ce bilan semble mieux documenté dans le cas de Gaza, l’évaluation du nombre de victimes directes et indirectes de la guerre au Liban sera certainement plus difficile à effectuer, si des méthodes de recensement ne sont pas déployées dès à présent.
Conclusion
En fin d’analyse, les rapports sur le Liban et Gaza excluent un grand nombre de coûts liés à la guerre (les coûts environnementaux des armes non conventionnelles, les risques liés aux explosifs, les coûts de la prise en charge des blessés des guerres et des personnes handicapées, les coûts pour la protection sociale, etc.), des coûts qui sont pourtant inclus dans le rapport sur l’Ukraine. Par conséquent, selon la BM, la majorité de la facture des dommages au Liban comme à Gaza[21], proviendrait des destructions du secteur du logement, alors qu’elles ne constituent que le tiers des coûts de la «guerre» pour l’Ukraine (57,6 milliards d’USD sur un total de 176 milliards d’USD) (BM 2025c, p. 36). Cette différence est clairement le reflet de la place inégale accordée aux autorités et aux institutions publiques dans les différents exercices d’évaluation.
Plus particulièrement, le cas du Liban montre de manière exemplaire combien les rapports de la BM constituent des leviers pour redéfinir le rôle de l’État, ou encore sa place au sein des relations internationales (Hariri et al. 2020). Depuis 2016, la BM publie régulièrement des rapports trimestriels sur l’économie libanaise[22], dont certains sont devenus des «classiques» dans le champ du débat public, académique ou médiatique, laissant des marques indélébiles dans le langage ordinaire ou scientifique, et un impact durable sur la manière de comprendre ou d’analyser l’économie libanaise et ses multiples crises[23].
Jouissant du prestige de la BM – et de moyens techniques, scientifiques et financiers colossaux qui contrastent avec la faiblesse des institutions locales, publiques et privées, de production des données – ces rapports sont rarement contestés[24].
Aussi, la place accordée à l’État est paradigmatique dans ce genre de rapports, car elle éclaire sur les fonctionnalités de l’évaluation, et sur les jeux de langage (et de pouvoirs) entre le locuteur (la BM) et les multiples récipiendaires de ses discours : l’État libanais, les «autres» pays donateurs, les acteurs de l’aide internationale et les grandes instances du droit international qui s’appuient sur ces évaluations pour donner le ton aux efforts de soulagement ou aux reconstructions post-conflits (Hariri et al. 2021).
En outre, les évaluations économiques des dommages et des pertes des guerres, tout comme leurs bilans humains, représentent aujourd’hui des enjeux politiques majeurs, portant principalement sur la reconnaissance (ou le déni) de crimes de guerre, de crimes de génocide, et de crimes contre l’humanité. Avec les mandats d’arrêts de la Cour Pénale Internationale contre des dirigeants russes et israéliens, ces exercices d’évaluation «en temps de guerre» auront probablement des répercussions importantes pour l’avenir du droit international.
Toutefois, les rapports de la BM tendent souvent à sous-estimer les coûts économiques réels des guerres et des conflits armés, ainsi que leur bilan en vies humaines. Une récente revue critique de la méthodologie DaLA en Ukraine avait montré que les données produites par l’approche englobante de la BM diffèrent considérablement des évaluations «objet par objet» que les publications scientifiques ont pu mettre en évidence à travers des analyses détaillées à petite échelle, avec des approches ponctuelles «au niveau du sol» [ground-level approach] et «spécifiques à un objet». Les auteurs en concluent que «l’approche d’évaluation rapide généralisée utilisée par la Banque mondiale ne peut pas servir de base à l’élaboration de mécanismes de compensation[25]» pour l’Ukraine (Zhuk et al. 2023, p. 211).
Toutefois, les remarques précédentes ne remettent pas en question la méthodologie englobante employée par la BM. S’il faut en retenir un point important, c’est que les estimations de la méthodologie DaLA ne doivent pas être décontextualisées, et leurs hypothèses ne peuvent pas être séparées des intentions, des fonctionnalités et des usages politiques qui président à leur élaboration.
Enfin, si la méthodologie DaLA employée par la BM a ses limites, elle a aussi ses vertus. Contrairement à une approche d’évaluation post-désastre, la DaLA a vocation à chiffrer des coûts effectifs et des coûts anticipés, permettant graduellement de corriger les anticipations, ou d’agir en cours de guerre pour préserver certains domaines jugés critiques ou vitaux pour les pays en guerre, ou même pour le droit international. Par exemple, l’évaluation répétée sur 4 exercices en Ukraine montre comment les effets cumulés du conflit (sur l’environnement, sur la santé publique, sur la sécurité intérieure ou sur la violence basée sur le genre, etc.) conduisent, d’année en année, à un alourdissement de la facture de la guerre pour les populations ukrainiennes, indépendamment de l’intensification des faits militaires.
Alors même que les guerres continuent de s’intensifier, une évaluation intermédiaire des impacts de la guerre a l’avantage de dresser un bilan «en mouvement» d’une guerre en cours, ce qui permet non seulement de guider l’action des États et des organisations internationales, mais, en plus, de faire pression pour limiter les dégâts, notamment dans des secteurs sensibles pour le droit international (comme la destruction des sites et des monuments, ou la déportation forcée des enfants, etc.). De ce point de vue, l’évaluation intermédiaire pourrait être considérée comme étant plus importante (politiquement) que l’évaluation ex post, malgré l’incertitude de ses estimations, en raison de ses usages qui en font un instrument de pression permettant d’influencer le cours d’une guerre, ou de limiter ses dommages et ses pertes, notamment dans des secteurs jugés sensibles pour la paix mondiale.
Bibliographie
- Banque Mondiale (BM), 2025a, “Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA),” en collaboration avec le CNRS-L, Washington DC, March 2025.
- BM, 2025b, “Gaza and West Bank Interim Rapid Damage and Needs Assessment,” Washington DC, February 2025.
- BM, 2025c, “Fourth Rapid Damage and Need Assessment. February 2022 - December 2024,” Washington DC, February 2025.
- BM, 2024a, “Lebanon Interim Damage and Loss Assessment,” Washington DC, November 2024.
- BM, 2024b, “Gaza Strip Interim Damage Assessment,” Washington DC, March 2024.
- BM, 2024c, “Third Rapid Damage and Need Assessment. February 2022 - December 2023,” Washington DC, February 2024.
- BM, 2021a, Lebanon Economic Monitor, Fall 2021, “The Great Denial,” Beirut, Lebanon.
- BM, 2021b, Lebanon Economic Monitor, Spring 2021, “Lebanon Sinking (to the Top 3),” Beirut, Lebanon.
- BM, 2020a, “Beirut Rapid Damage and Needs Assessment,” Washington DC.
- BM, 2020b, Lebanon Economic Monitor, Fall 2020, “The Deliberate Depression,” Beirut, Lebanon.
- BM, 2013, “Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict,” Washington DC.
- CNRS, National Center for Natural Hazards & Early Warning, 2024, “Israeli offensive on Lebanon 2023-2024. Overview of attacks and damages across key sectors,” In collaboration with UNDP.
- Déclaration de Genève, 2008, “Global Burden of Armed Violence,” Geneva Declaration Secrétariat, Genève, Suisse.
- ESCWA, 2024, “The multidimensional impact of Israeli attacks on Lebanon,” en collaboration avec UN Habitat.
- Goldman, Sharon, Ari M. Lipsky, Irina Radimislensky, Adi Givon, Ofer Almog, Avi Benov, Eldad Katorza, & Israel Trauma Group, 2024, “October 7th mass casualty attack in Israel: Injury profiles of hospitalized casualties,” Annals of Surgery Open, 5(3):e481.
- Gouvernement du Liban, 2024, “Situational Report no 49,” The Government’s Emergency Committee, 25/11/2024, Beyrouth, Liban.
- Hariri Nizar, Antoun Racquel, Haykal Sarah, 2020, «La rhétorique nationaliste dans les discours de la Banque Mondiale : déconstruire quelques mythes sur le travail des réfugiés syriens au Liban»,” Actes du 61e congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française (AIELF), Santiago, Chili.
- Hariri Nizar, Bou Nader Raymond, Makhlouf Youmna, & Scala Michele, 2021, «Étude multidimensionnelle des impacts des explosions sur les quartiers endommagés ,” Hal, Archives ouvertes.
- Jamaluddine Zeina, Checchi Francesco, & Campbell Oona, 2023, “Excess mortality in Gaza: Oct7–26, 2023,” The Lancet 402, no. 10418: 2189-2190.
- Khatib Rasha, Martin McKee, & Salim Yusuf, 2024, “Counting the dead in Gaza: difficult but essential,” The Lancet 404, no. 10449: 237-238.
- Nations Unies, 2025, “‘More than a human can bear’: Israel›s systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023,” UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, Human Rights Council, Genève.
- Zhuk Valerii, Pugachov Mykola, Shpykuliak Oleksandr, Bezdushna Yuliya, & Popko Yevheniya, 2023, “Application of accounting for the assessment of war losses for agribusiness enterprises of Ukraine,” Agricultural and Resource Economics, 9(3): 197-215.
------------------------------------------
[1] “Beyond the physical and financial impacts that are more readily quantified, the RDNA4 provides a qualitative description of how people’s lives have been dramatically altered since February 2022.” (BM 2025c, p. 10).
[2] “This report presents the Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) related to the impact of the 2023-2024 conflict that affected Lebanon” (BM 2025a, p. 9).
[3] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/un-report-palestinian-detainees-held-arbitrarily-and-secretly-subjected
[4] “[…] globally established and recognized. This methodology has been applied globally in post-disaster and post-conflict contexts to inform recovery and reconstruction planning. This transparent and standard assessment methodology contributes to coordinated and coherent national and international efforts” (BM 2025a, p. 52).
[5] “Beyond the physical and financial impacts that are more readily quantified, the RDNA4 provides a qualitative description of how people’s lives have been dramatically altered since February 2022. A qualitative description of how people’s lives have been dramatically altered since February 2022” (BM 2025c, p. 10).
[6] “The GoU’s Registry of Damaged and Destroyed Property (RDDP) mandates the verification and registration of damaged assets […] it also acts as a centralized tool for monitoring the extent, nature, and location of damaged assets and progress on their repair and reconstruction” (BM, 2025c, p. 93).
[7] “The RDNA provides a comprehensive analysis of the damage caused to Ukraine by Russia’s full-scale war. The report determines the amount of funds needed for recovery and reconstruction. […] In 2024, 28 agreements totaling USD 31.8 billion were signed, including USD 22.9 billion in grants. Millions of Ukrainians have received support through Ukraine’s cooperation with the World Bank.” https://mof.gov.ua/en/news/government_of_ukraine_and_international_partners_will_present_the_fourth_rapid_damage_and_needs_assessment_rdna4-5028
[8] Consulter: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/03/09/l-onu-considere-que-les-colonies-israeliennes-relevent-du-crimede-guerre_6221002_3210.html
[9] “Given the loss of documentation and potential loss of property, there is a long-term uncertainty in land tenure and property rights” (BM 2025c, p. 53)
[10] Un bilan humain provisoire montrait plus de 3768 morts et 15669 blessés du côté libanais selon le dernier recensement officiel du gouvernement avant le cessez-le-feu, à la date du 25 novembre 2024 (Gouvernement du Liban 2024).
[11] “The ongoing conflict in the Gaza Strip has caused loss of life, forced displacement, and damages to social, physical, and productive infrastructure at an unprecedented speed and scale. The United Nations (UN), European Union (EU) and other humanitarian and development partners have repeatedly called it an extremely severe humanitarian crisis” (BM 2024b, p. 1).
[12] Un discours officiel repris sur le site [Government Portal] du gouvernement : https://www.kmu.gov.ua/en/news/uriad-i-svitovyi-bank-predstavyly-rdna3-potreby-na-vidbudovu-ukrainy-skladaiut-vzhe-maizhe-486-miliardiv-dolariv
[13] Ainsi, la BM rappelle elle-même que ses analyses sectorielles (en Ukraine comme ailleurs) ne permettent pas de prendre en compte l’impact d’un secteur sur un autre, et qu’une future évaluation sera toujours nécessaire pour intégrer « les différents types de réformes qui dépendront de la trajectoire de la guerre […] tout en intégrant les zones où les combats ont été limités, voire inexistants, mais qui auraient souffert de sous-investissements pendant la guerre » (BM 2024c, p. 27).
[14] “Illegal deportation or transfer or illegal deprivation of liberty” (BM 2024c p. 61).
[15] “The burden of investigating and prosecuting war crimes on top of carrying out normal responsibilities” (BM 2024c, p. 165).
[16] CeSSRA, 2024, «Plus que de l’aide, le Liban a besoin d’un État social de droit » https://civilsociety-centre.org/paper/more-aid-lebanonneeds-welfare-state-upholds-rule-law
[17] “The alleged use of white phosphorus in Lebanon was not independently and scientifically verified by the World Bank as part of this interim assessment” (BM 2024a, p. 14).
[18] https://publicworksstudio.com/en/map-of-israeli-attacks-on-lebanon-2023/
[19] https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorous-use-risks-civilian-harm
[20] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/lebanon-evidence-of-israels-unlawful-use-of-white-phosphorus-in-southern-lebanon-as-cross-border-hostilities-escalate/
[21] Plus précisément, les dommages du secteur du logement s’élèvent à plus de 4,5 millions d’USD sur un total de 6,38 millions d’USD (tous secteurs confondus), soit 67 % des dommages du Liban (BM 2025a, p. 19), alors qu’en Palestine ils représentent la moitié (BM 2025b, p. 4).
[22] https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor
[23] On leur doit par exemple des expressions devenues courantes dans l’analyse des crises au Liban, comme « la Dépression délibérée » (BM 2020b) ou « le grand déni » (BM 2021a), deux catégories analytiques qui font du Liban l’archétype d’une crise aiguë de la gouvernance et de la corruption des élites politiques. Ou encore le rapport classant la crise libanaise parmi les 10 plus grandes crises contemporaines, voire l’une des 3 plus grandes crises (BM 2021b).
[24] En revanche, des évaluations de ce type auraient probablement été considérées comme une atteinte à la souveraineté en Israël, si elle avait été faite sans concertation avec le gouvernement israélien (mis à part le fait que de multiples instances publiques et privées en Israël conduisent régulièrement ce type d’évaluations, à des échelles locales, sectorielles ou au niveau national, sans besoin d’une assistance technique de la part de la BM).
[25] “The generalized rapid assessment approach used by the World Bank cannot be taken as a basis for the development of compensation mechanisms.” (Zhuk et al. 2023, p. 211).






