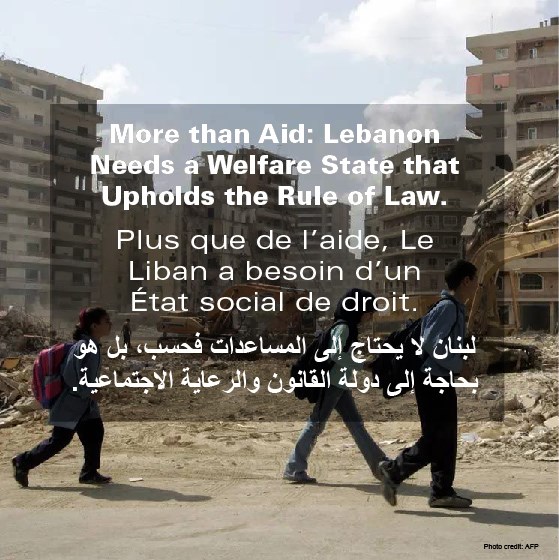
ألا تعتذرون؟ يسألنا العالم
لن تعطينا المغفرة. إن موتنا، وحده، هو الذي يأخذ شكل المغفرة. ونحن نعتذر.. نعتذر لأننا تأخرنا في الرحم، ولكن الولادة عسيرة في هذه الأيام، والجنود الغزاة يحاصرون مدخل الرحم. وأنت الشاهد المحايد أيها العالم
محمود درويش
وداعاً أيتها الحرب وداعاً أيها السلام
- You do not apologize? The World asks us.
- You will not grant us forgiveness. Only our death takes the form of forgiveness. And we apologize… We apologize for being late in the womb, but childbirth is difficult these days, and the invading soldiers besiege the entrance to the womb. And you, O World, are the neutral witness.
Mahmoud Darwish, Farewell War! Farewell Peace!
The new war between Lebanon and Israel – hard to date precisely, as the bombardments have been intensifying over the past 12 months – took a destructive turn in September 2024. It is now unfolding as a massacre of unprecedented magnitude. Although the war is still in its early stages, the civilian death toll already exceeds twice that of the 2006 war. Tens of thousands have been injured, and millions have been displaced.
In this context, it was expected that donors and the international community, particularly Lebanon’s so-called “friends,” would mobilize to aid a country already burdened by one of the world’s most severe economic crises since 2019. Both Lebanese and non-Lebanese residents are struggling to cope or survive amidst countless overlapping crises. Today, displaced persons constitute over 20% of the population (more than 1 million people, with numbers rising daily). Will international aid meet these immense needs? And what is the Lebanese government doing to contain this crisis?
The promises of aid from the international community now seem to dominate the Lebanese government’s agenda. It is a confounding situation where the government of a country at war limits its role to nothing more than a fundraising campaign.
On the donors’ side, initiatives are quickly unfolding. The Canadian government has already mobilized 15 million dollars [1] , while the United Nations is increasing its fundraising efforts with a target of over 1 billion dollars by the end of 2024 [2] . The European Union, Lebanon’s second-largest donor, has decided to offer an additional EUR 10 million, followed by another EUR 30 million, bringing its total aid package for 2024 to over EUR 100 million [3] . France, alongside Qatar, has delivered an initial shipment of 27 tons of medical supplies and equipment [4] . It is difficult to estimate all the aid received thus far here, as the Saudis, Emiratis and Qataris are regularly regularly providing aid. Moreover, an international interministerial conference for Lebanon, initiated by the French President, is set to take place in Paris [5] on October 24, 2024. [6] While it is still too early to predict the outcome of this conference, we must question its modes of operations and the risks it may pose to local governance and crisis management mechanisms.
A large-scale deployment of international aid is now imminent, exceeding even what was mobilized for Palestinian victims and survivors. This raises the question: How do Lebanese lives compare to Palestinian ones? And what is the value of these lives on the “Levantine blood market,” to borrow once more from Mahmoud Darwish’s words? As this war already involves multiple countries in the region (such as Yemen, Iraq, Iran, and Syria) and threatens to escalate into a regional conflict, how will this international aid be deployed, and according to what priorities and objectives?
In the past, international aid to Lebanon has played a dual role: it is offered during acute crises to support a bankrupt economy, and it directly or indirectly legitimizes the political elite responsible for the system’s collapse. Therefore, this aid serves, both, as a lifeline for the prevailing economic-political system and the primary funding source for civil society. No matter how dynamic civil society networks of solidarity may be, they cannot (and must not) replace the state in crises management or prevention, a fortiori in times of wars.
Today, civil society is left to fend for itself, and, whether we like it or not, the various diaspora-led fundraising efforts hide the lack of investment by the local elites in emergency relief or humanitarian aid to alleviate the suffering of war victims. It is disheartening to observe these recurring patterns, with Lebanon’s leaders, all of whom are billionaires, lamenting the state’s lack of resources, which they themselves have plundered, all the while appealing to the international community’s generosity and imploring private initiatives to mobilize. [7]
Once again, Lebanese and non-Lebanese disaster-stricken populations have only two means of survival to resort to. First, the generosity of international donors, whose motivations are now viewed with suspicion by the majority of people, as these same states either directly supply weapons to the Israeli aggression, enabling it to wound, mutilate, burn, and exterminate an entire people, or, at the very least, through their silence, tacitly endorse the massacres that Israel is committing in every single country in our region.
The second consists of informal solidarity networks, which often reinforce “deadly” sectarian identities, [8] stifling any hope for a secular and civil state for all and undermining access to rights.
What we lament, above all, is the absence of any protection grounded in the rule of law.
It is telling that the current wartime government’s first economic policy was to raise the price of bread for the umpteenth time (there were 15 such hikes in 2021 alone) that followed yet another (debt-)financed plan through the World Bank.
With three-quarters of the population living in poverty before the war [9] , and in the context of a bankrupt state and collapsing public administrations, Lebanon managed to make one notable achievement in the past 12 months: a renewed (albeit symbolic) emphasis on the importance of universal social protection. On the one hand, Parliament passed a law in December 2023 establishing retirement schemes for private-sector workers. On the other hand, the government adopted a National Social Protection Strategy. This offers valuable momentum that must continue. For these reforms to be more than empty promises, civil society, public actors, and the international community must now work together to reinforce this vision of a welfare state that offers protections based on systems of foresight and on social rights founded on the principles of universality.
It is in this spirit that we reiterate the need for humanitarian aid and solidarity initiatives by the international community, rather than offering aid that would erode what remains of universality in an already collapsing social protection system and of a crumbling state that the Lebanese alone must rebuild.
The ecocide in southern Lebanon, the urbicide of Beirut’s southern suburb, the devastation of large parts of the Beqaa Valley, and the systemic destruction of agriculture, education, infrastructure, and basic living conditions for thousands of Lebanese are not merely the morbid byproducts of the Israeli war on Lebanon: They represent an exorbitant bill that the Lebanese state will ultimately have to pay.
Unfortunately, the current war carries another grim forecast. Lebanon’s healthcare sector, which is predominantly private, has demonstrated relative resilience in adapting to wartime conditions, both in the past and today. However, this resilience is the responsibility of the state, which must not resort to the logic of NGO-ization. The Ministry of Public Health, for its part, must no longer operate as a glorified NGO. Reinvesting in public healthcare and social welfare institutions was already a pressing need during times of crisis; it is now a matter of survival during wartime, at a time when health workers (many of whom are volunteers or unpaid) are targeted by Israeli attacks, with hospitals and ambulances directly targeted or threatened, and the number of disabled individuals on the rise.
This prognosis is not meant to be a pessimistic one.
At a time when the ceasefire and aid to victims are certainly priorities, the construction of a welfare state that upholds the rule of law seems to become a vital necessity to eschew the risks of crises and conflicts, current and future, and to hope to break the vicious cycle of perpetual crises and wars in Lebanon. Aren’t the mutilated bodies of yesterday and tomorrow, in the likeness of a devastated society, already paying the price for the delay in the construction of a social state in Lebanon?
[4] According to the French Government
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/lebanon/news/article/leb...
[6] Historically, meetings of the International Support Group for Lebanon have been convened by the Élysée Palace, such the various international conferences (Paris 1, 2, 3). The most recent, the CEDRE Conference of April 2018, known as Paris 4, promised USD 11 billion in aid that was never disbursed, as it was conditioned by reforms that were not implemented.
[7] On August 7, 2020, just three days after the Beirut Port explosion, the then-President of the Republic (and the last to day, given the failure to elect a successor), Michel Aoun, sought to console the nation by welcoming the return of international aid in the aftermath of the explosion. In his view, this marked the end of the financial embargo on the Lebanese state. https://www.lorientlejour.com/article/1228706/aoun-sempresse-de-detricot...
[8] Term coined by Amine Maalouf. Amine Maalouf, Les Identités Meurtrières (Deadly Identities), Paris, Grasset, 1998.
[9] According to UN ESCWA estimates in 2021: https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf
ألا تعتذرون؟ يسألنا العالم
لن تعطينا المغفرة. إن موتنا، وحده، هو الذي يأخذ شكل المغفرة. ونحن نعتذر.. نعتذر لأننا تأخرنا في الرحم، ولكن الولادة عسيرة في هذه الأيام، والجنود الغزاة يحاصرون مدخل الرحم. وأنت الشاهد المحايد أيها العالم
محمود درويش
وداعاً أيتها الحرب وداعاً أيها السلام
- Vous ne vous excusez pas? nous demande le Mon de
- Tu ne nous accorderas pas de pardon. C’est notre mort seule qui prend la forme du pardon. Et nous nous excusons.. Nous nous excusons d'être en retard dans l'utérus, mais l'accouchement est difficile de nos jours et les soldats envahisseurs assiègent l'entrée de l'utérus. Et toi, tu es le témoin neutre, ô Monde.
Mahmoud Darwich, Adieu, Guerre! Adieu, Paix!
La nouvelle guerre entre le Liban et Israël – difficile à dater, tant les bombardements s'intensifient depuis plus de 12 mois – a pris un tournant destructeur depuis septembre 2024. Elle se transforme aujourd’hui en un massacre d’une ampleur inédite. La guerre n’est qu’à ses débuts, et pourtant le nombre de morts civils dépasse déjà le double de celui de la guerre de 2006. Les blessés se comptent par dizaines de milliers, et les déplacés en millions.
Dans ce contexte, il était prévisible que les donateurs et la communauté internationale, et plus particulièrement les pays dits « amis du Liban », se mobilisent pour venir en aide à un pays déjà accablé par une crise économique des plus sévères au monde depuis 2019. Les populations résidentes, libanaises ou non-libanaises, sont éprouvées dans leurs capacités à s’adapter ou à survivre face à des crises multiples qu’on n’arrive plus à compter. Aujourd’hui, les déplacés comptent pour plus de 20% de la population (plus de 1 million de déplacés, mais les chiffres augmentent tous les jours). L’aide internationale sera-t-elle à la hauteur des besoins ? Parallèlement, que fait le gouvernement libanais pour contenir cette crise ?
Les promesses d’aides en provenance de la communauté internationale semblent être aujourd’hui le souci principal de l’État libanais. Étrange situation où le gouvernement d’un pays en guerre voit son rôle se réduire à celui d’une campagne de levée de fonds.
Du côté des donateurs, les initiatives ne se font pas attendre. Le gouvernement du Canada a déjà mobilisé une aide de 15 millions de dollars [1] , les Nations Unies augmente la levée des fonds en tablant sur une aide dépassant au total le 1 milliard de dollars avant la fin de 2024 [2] , l’Union Européenne, deuxième donateur au Liban a décidé une augmentation de 10 millions, puis de 30 millions d’euros supplémentaires, pour atteindre une enveloppe globale dépassant les 100 millions d’euros pour 2024 [3] . Les Français ont livré une première aide avec les Qataris de quelque 27 tonnes de médicaments et d’équipement médical [4] . Il est difficile ici de recenser toutes les aides, les Saoudiens, les Emiratis et les Qataris acheminant régulièrement de leurs côtés des aides difficiles à estimer. Enfin, une conférence internationale interministérielle pour le Liban se tiendra le 24 octobre 2024 à Paris [5] , à l’initiative du Président français [6] . S’il est encore tôt pour faire un pronostic sur l’issue de cette nouvelle conférence, nous sommes néanmoins en droit de nous interroger sur ses modes opératoires, et sur les risques qu’elle pose sur les mécanismes locaux de la gouvernance et de la gestion des crises.
Désormais, se profile à l’horizon un déploiement d’urgence d’une aide internationale de grande ampleur au Liban, qui dépasse déjà ce qu’on a pu mobiliser pour les victimes et rescapés palestiniens. C’est à se demander combien comptent les vies libanaises, comparées à celles des Palestiniens, et combien valent les deux « sur la bourse du sang oriental », pour emprunter encore une formule de Mahmoud Darwich. Face à une guerre qui implique déjà un grand nombre de pays dans la région (le Yémen, l'Irak, l’Iran, la Syrie sont déjà des parties prenantes), et qui risque à tout moment de dégénérer en un conflit régional à grande échelle, comment sera déployée cette aide internationale, selon quelles priorités, et dans quelles visées ?
Pour le Liban, les aides internationales ont joué dans le passé un double rôle : elles interviennent dans les moments de crises aiguës pour soutenir une économie en faillite ; elles contribuent directement ou indirectement à la légitimation d’une élite politique qui a conduit le système à son effondrement. Ces aides sont donc à la fois la condition de survie du système économico-politique en vigueur, et la principale source de financement pour la société civile qui, quel que soit son dynamisme et la force de ses réseaux de solidarité, ne pourra (et ne devra) jamais se substituer à l’État, notamment dans ses prérogatives de gestion ou des préventions des crises, et a fortiori, des guerres.
Aujourd’hui, la société civile est livrée à elle-même, et le paysage des multiples levées de fonds par la diaspora cache, qu’on le veuille ou pas, le manque d’investissement des élites locales dans les efforts d’urgence, de secours ou de soulagement des souffrances des victimes de guerre. Paysage devenu désespérant pour celui qui observe ses répétitions, quand les dirigeants, tous milliardaires, se réunissent pour déplorer le manque de moyens de l’État qu’ils ont eux-mêmes pillé, et pour en appeler à la générosité de la communauté internationale et implorer les mobilisations des initiatives privées [7] .
Aujourd’hui encore, les populations sinistrées, libanaises et non-libanaises, ne peuvent compter que sur deux filets de sauvetage. D’une part, la générosité des bailleurs de fonds internationaux, dont les motivations apparaissent de plus en plus suspectes aux yeux du plus grand nombre dans la mesure où ces mêmes États au pire soutiennent directement l’agresseur israélien en lui fournissant les armes même qui blessent, mutilent, démembrent, brûlent, et éradiquent un peuple, au mieux de par leur silence contribuent à légitimer un massacre qui n’épargne plus un seul pays de la région.
D’autre part, les réseaux de solidarités informelles, qui nourrissent directement les identités “meurtrières” [8] confessionnelles, muselant les espoirs d’un État séculaire et civil pour tous, et sapant de ce fait l’accès aux droits.
Ce qu’on déplore donc avant tout, c’est l’absence de toute mesure de protection fondée sur le droit.
Il est remarquable par exemple que la première mesure de politique économique du gouvernement actuel en temps de guerre a été la hausse du prix du pain, une énième augmentation (on en comptait 15 par exemple dans la seule année 2021) qui intervient dans le sillage d’un énième plan de financement (par dette) via la Banque mondiale.
Avec une pauvreté qui touchait les trois quarts de la population avant la guerre [9] , et dans un contexte de faillite de l’État, et d’effondrement des administrations publiques, le Liban a pu dans les derniers 12 mois réaliser au moins un progrès notable vers la réaffirmation (de principe) de l’importance de l’universalité de la protection sociale. D’une part, le parlement a voté une loi de décembre 2023 sur les systèmes de retraite pour les travailleurs du secteur privé et, d’autre part, le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour la protection sociale. C’est un momentum à saisir. Pour que ces réformes ne restent pas lettres mortes, il est important aujourd’hui que la société civile, les acteurs publics et la communauté internationale agissent de concert pour renforcer cette vision de l’État social qui assoit ses protections sur des systèmes de prévoyance et sur des droits sociaux fondés sur des principes universalistes.
C’est principalement dans ce sens qu’il serait nécessaire d’acheminer l’aide humanitaire et les initiatives de solidarité de la communauté internationale, et non pas dans un sens qui minerait ce qui reste d’universalité dans un système de protection déjà en faillite, et d’un État déliquescent qu’il urge aux Libanais seuls de bâtir.
L’écocide du Sud Liban, l’urbicide de la banlieue Sud de Beyrouth, la dévastation de vastes zones de la Bekaa, la destruction systémique du secteur de l'agriculture, de l'éducation, de l'infrastructure et des conditions même de vie pour des milliers de Libanais ne constituent pas uniquement un sillage macabre de la guerre israélienne au Liban, mais également une facture exorbitante qu’il reviendra à l’État libanais de payer.
Toutefois et malheureusement, la guerre actuelle laisse aussi un autre présage. Le secteur de la santé au Liban, bien qu’il soit majoritairement privé, s’adapte tant bien que mal au contexte de la médecine de guerre. Il l’a montré dans le passé, et le montre aussi bien aujourd’hui. Mais sa résilience est une affaire d’État qui ne doit pas dépendre des logiques d’NGOisation, et le ministère de la santé publique ne peut pas rester une super-ONG. Réinvestir les acteurs publics dans la santé et le bien-être social était déjà une affaire pressante en temps de crise, et devient une urgence vitale en temps de guerre, au moment où les travailleurs dans le secteur de la santé (dont beaucoup sont des volontaires, des travailleurs non payés) sont pris pour cibles par les attaques israéliennes, quand les hôpitaux ou les ambulances sont ouvertement menacés et visés, et que le nombre de personnes handicapées ne cesse d’augmenter.
Ce pronostic ne se veut pas pessimiste.
Au moment où le cessez-le-feu et l’aide aux victimes sont certes prioritaires, la construction d’un État “social” de droit semble devenir une nécessité vitale pour désamorcer les risques de crises et de conflits, actuels et futurs, et espérer sortir le Liban du cercle vicieux des crises et guerres perpétuelles. Les corps mutilés d’hier et de demain, à l’image d’une société sinistrée dans son ensemble, ne payent-ils pas d’ores et déjà le prix du retard dans la construction d’un État social au Liban?
[4] Selon le gouvernement français: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/lebanon/news/article/leb...
[6] Historiquement, les réunions du Groupe de Soutien International au Liban sont convoquées par l’Élysée, à l’instar des multiples conférences internationales (Paris, 1, 2, 3). La dernière en date, la Conférence CEDRE d’avril 2018, dite Paris 4, avait promis des aides conditionnelles de 11 milliards de dollars, qui n’ont jamais été accordées, car conditionnées par des réformes qui n’ont jamais vu le jour.
[7] Déjà le 7 août 2020, à peine 3 jours après l’explosion du port, le Président de la république de l’époque (dernier en date, vu l’incapacité à élire un nouveau) Michel Aoun consolait la nation en se félicitant du retour des aides internationales post-explosion, ce qui annonçaient selon lui la fin de l’embargo financier sur l’État libanais. https://www.lorientlejour.com/article/1228706/aoun-sempresse-de-detricot...
[8] Pour emprunter l’expression à Amine Maalouf. Amine Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998.
[9] Selon les estimations publiées par l’UN ESCWA en 2021: https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf






